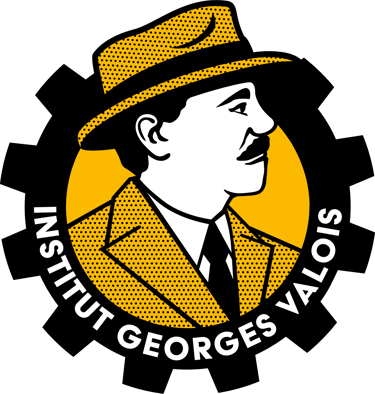Accélérationnisme ou surhumanisme


Toutes les postures intellectuelles ne se valent pas. C’est comme ça, je n’y peux rien. Quand tout est pourri, la volonté de conserver a moins de valeur que la volonté de tout incendier. C’est comme ça, je ne fais pas les règles. La civilisation occidentale pourrit de l’intérieur. Elle a beau croître, il lui devient chaque jour plus coûteux de se maintenir car plus aucun principe directeur ne l’anime. L’Occident se fatigue d’être lui-même, se lamente d’un héritage toujours plus lourd à porter. Atlas tremble, ses jambes flagellent.
Malgré cela, notre vieil Occident reste pénétré de mystique chrétienne. Il semble tout simplement impossible d’y échapper. L’un des signes les plus frappants est sans-doute la peur de l’Apocalypse. Elle revient cycliquement, émergeant dans les consciences en temps de crise, faisant sourdre la crainte ancestrale d’une catastrophe qui mettrait fin au monde tel que nous le connaissons. C’est presque devenu un jeu, parmi les intellectuels, de prédire l’effondrement de notre civilisation, de rechercher de nouveaux facteurs contributifs. L’on en a même fait une discipline qui se targue d’être scientifique : la collapsologie.
Mais savons-nous vraiment ce qu’est un effondrement civilisationnel ? Rien n’est moins sûr. Nous peinons à imaginer autre chose qu’un champs de ruines et de regrets, nous voudrions croire que rien ne pousse sur les terres désolées d’une civilisation défunte, mais nous aurions tort. L’exemple de l’empire romain d’Occident est très parlant. L’on parle d’une « chute », d’un « effondrement », mais ce que l’on observe dans les faits, c’est la disparition d’un empire moribond et avachi qui cesse simplement d’exister lorsque l’empereur est déposé et que personne ne prend sa place. Pas de grande catastrophe, pas d’orgie de pillages. De nouvelles structures politiques apparaissent ou prennent une autre place, portant l’héritage de Rome dans de nouvelles direction. La peur de l’effondrement est un rejet d’une loi universelle : tout ce qui a un commencement a une fin. Cette fin mène toujours à quelque chose d’autre.
Il n’en est pas moins vrai que nos sociétés sont vulnérables. Elles sont devenues trop complexes. Si complexes qu’il ne semble pas certain qu’elles puissent maintenir leur forme actuelle. Comment remplace-t-on les ingénieurs nécessaires au fonctionnement des infrastructures quand le niveau scolaire atteint des profondeurs tellement abyssales que l’on ne sait plus comment l’en tirer ? Alors que j’écris ces lignes, je vois un camion poubelle déployer un bras mécanique pour soulever de terre une immense benne à ordures. Se rend-on compte qu’il suffirait à une poignée de personnes déterminées de saboter systématiquement ces camions pour plonger une métropole dans le chaos ? Une société complexe repose sur un degré élevé d'interdépendance entre ses membres, les dysfonctionnements arrivent donc en cascades.
Beaucoup de gens sentent que l’Occident, en dépit de ses camions poubelles dernier cri, arrive en bout de course, qu’il est exsangue. Sa forme actuelle vit ses derniers soubresauts même si nous ne pouvons pas encore déclarer la mort clinique. Je ne vois que deux routes pour se tirer de cette impasse, pour ne pas sombrer dans la folie pessimiste où l’on veut nous maintenir. Il faut être accélérationniste ou surhumaniste. L’auteur de ces lignes ne saurait vous exhorter à choisir, marchant lui-même constamment sur le fil séparant les deux chemins. Vous pourriez vous en remettre au hasard et tirer votre décision à pile au face sans craindre de faire mauvaise pioche.
L’accélérationniste est le plus fataliste des deux. Si la société est fichue, prête à s’effondrer, autant la pousser dans le vide, autant craquer la dernière allumette et allumer soi-même l’incendie. Partir selon nos propres termes, en somme. Car, à bien y réfléchir, comment ne pas souhaiter que tout flambe ? Tout est pourri dans le royaume de France. Un pays de consommateurs et de contribuables, tout juste bons à réclamer que l’État prenne davantage de place dans nos vies, voilà ce que nous sommes devenus. Ni grandeur ni beauté, seulement la réalité glauque d’un peuple sans rêves et qui se laisse docilement remplacer pour peu que quelqu’un se plaise à lui promettre que cette fois-ci c’est bon, l’égalité c’est pour demain.
Ce triste constat ne fait pas nécessairement de l’accélérationnisme un pessimisme désabusé. Au contraire même, quelle joie que de se libérer du carcan d’un monde mourant, de liquider ses dettes et de rompre ses serments. Un seul soucis : vivre libéré de la société moribonde, lui larder le corps de coups de surins, abréger ses souffrances et peut-être les nôtres. L’accélérationniste n’est non plus un solitaire, s’il veut faciliter l’arrivée du monde à venir, il a tout intérêt à s’associer, créer ou rejoindre un réseau une communauté. Les institutions périssent mais le pouvoir ne disparaît pas, il change de mains. L’accélérationniste a tout intérêt à pouvoir infléchir le cours des choses après l’« effondrement ». Il ne peut le faire seul.
Le surhumanisme est le cousin optimiste de l’accélérationniste. Peut-être moins réaliste, aussi. Inspirée par le nietzschéisme, il s’agit de faire muter la société, la sortir de sa torpeur par la rupture totale avec ses valeurs décrépies, « par-delà le bien et le mal ». Oh bien sûr, il ne s’agit pas là d’une mince affaire, et il est impossible de savoir combien de temps il nous reste. Mais une entreprise de régénération des valeurs pourrait être salvatrice si elle changeait notre trajectoire à temps.
Je ne peux guère concevoir ce surhumanisme que comme, au départ tout du moins, un individualisme. Il y a belle lurette que les masses sont entrées en politique. Pis, elles y ont été plongées, s’y sont noyées. Elles se débattent dans un jeu de dupes où elles ont censément tout pouvoir et sont réellement impuissantes. La division politique les a rendues méchantes, dominatrices et vindicatives. Voilà ce que la démocratie a fait de nous, des fauves qui espèrent, une fois tous les cinq ans, écraser leurs adversaires et leur imposer leurs vues. Le bons sens n’a plus cours, seule l’idéologie compte. Les gens n’ont plus de valeur, seulement leurs idées. Si l’on veut rendre à l’homme sa raison et sa force, il faut lui rendre un esprit libre et indépendant, détruire les chaînes que les bien-pensants de tous bords lui forgent. Il faudra que cela se fasse un esprit à la fois, pour commencer. Des gens qui relèvent la tête, à qui il reste assez de fierté et de cran pour oser penser sans qu’on leur bourre le crâne. Et ils feront des émules. Ils montreront l’exemple. Cela a déjà commencé et vous en connaissez peut-être. Advienne que pourra.
Toutes les postures intellectuelles ne se valent pas. Il est grand temps de cesser de prêter attention aux apôtres d’un Occident fantasmé, sans peurs et sans reproches, qui préfèrent se cacher les yeux et se boucher les oreilles plutôt que de voir la réalité en face : nos sociétés dépérissent, se contorsionnent de douleur. Mais nous pouvons encore y trouver la joie de la lutte. Non pas la lutte au nom de la « défense de l’Occident », ni contre ce dernier, mais contre ses démons intérieurs. Quoi qu’il advienne, l’héritage qui est le nôtre est colossal, car jamais civilisation n’a tant bâti. Alors pourquoi ces mines tristes ? Pourquoi ces regards apeurés ? Voyez plutôt le privilège qui est le nôtre : nous brûler tout entier à la tâche. Souffler sur les braises ou dans de nouvelles voiles. Avec nous, le déluge.