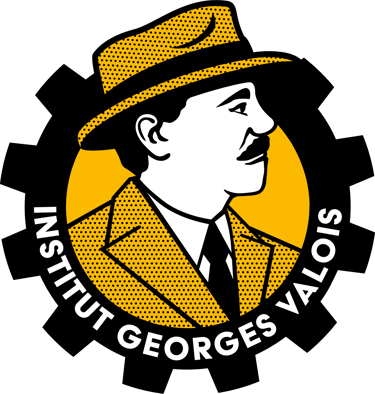Briser les chaînes de l’usure : Gesell et l’économie franche


Nous vivons sous le règne invisible d’une loi non écrite : celle de l’argent qui commande aux hommes. Intérêts, rentes, plus-values : ces prélèvements permanents paraissent naturels, comme si toute société était condamnée à nourrir la rente. Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi, et ce n’est pas une fatalité. Au tournant du XXᵉ siècle, un homme, à la fois commerçant, autodidacte et réformateur social d’inspiration proudhonienne, osa concevoir un système monétaire et foncier destiné à briser la domination des rentiers. Silvio Gesell, économiste germano-argentin, nomma son projet l’« économie franche ». Son ambition : que l’argent soit « un serviteur docile », et que le travail productif recouvre sa primauté sur la spéculation.
Né en 1862 à Saint-Vith, alors prussienne, Gesell connut très tôt les aléas du commerce international. Installé en Argentine à la fin du XIXᵉ siècle, il observa la paralysie d’une économie étranglée par la thésaurisation, les crises monétaires et la spéculation foncière. Il en conclut que le mal résidait non dans les abus d’un système, mais dans ses fondements mêmes : la monnaie et la propriété du sol.
De cette intuition naquit sa doctrine en trois volets, le Freiwirtschaft :
Freigeld « monnaie franche » – une monnaie soumise à une légère dépréciation régulière afin d’empêcher son stockage improductif et d’obliger sa circulation.
Freiland « terre libre » – suppression de la propriété privée spéculative du sol, remplacée par des baux publics ou collectifs, garantissant l’usage sans la rente.
Freihandel « commerce libre » – échanges libérés des manipulations monétaires et du parasitisme financier, mais soumis à l’intérêt collectif.
Freigeld
Pour Gesell, l’argent n’a pas vocation à être une marchandise que l’on détient pour le simple privilège de la détenir. Sa célèbre formule, extraite de L’Ordre économique naturel, résume l’esprit de sa réforme :
« De l'argent qui vieillit comme un journal, qui se gâte comme les pommes de terre, qui rouille comme le fer, qui s'évapore comme l'éther, un tel argent peut seul convenir comme moyen d'échange pour les pommes de terre, les journaux, le fer et l'éther ; un tel argent ne sera préféré à la marchandise ni par le vendeur, ni par l'acheteur. »
Concrètement, la monnaie franche est soumise à une dépréciation périodique d’environ 1 % par mois, matérialisée par l’apposition d’un timbre ou d’une marque de renouvellement sur chaque billet. Ce mécanisme, appelé demurrage (« taxation périodique des moyens de paiement »), empêche la thésaurisation et stabilise le pouvoir
d’achat en régulant à la fois la masse monétaire et sa vitesse de circulation. Cette monnaie fondante retire à l’épargne liquide son pouvoir de rançon. Elle pousse les détenteurs de capitaux à investir dans l’économie réelle ; l’intérêt privé retrouve alors sa juste place — non plus celle d’un créancier vivant de l’effort d’autrui, mais celle d’un producteur qui met ses moyens au service de la communauté.
Dès les années 1930, des communautés locales eurent l’audace de briser le monopole bancaire pour sauver leur économie. À Schwanenkirchen, en Bavière, le wära sauva temporairement une mine de lignite et ranima le commerce ; à Wörgl, en Autriche, les certificats de travail financèrent routes, ponts et chantiers publics, réduisant le chômage au moment où Vienne s’enlisait dans l’impuissance. La Fédération de l’économie libre du Liechtenstein tenta l’expérience et diffusa une monnaie fondante dans les communes de Triesen, Schaan et Eschen. Chaque fois, la renaissance fut immédiate : industries et chantiers rouverts, familles stabilisées, dignité rendue au travailleur. Chaque fois aussi, la finance et l’État central vinrent briser l’élan. Berlin, Vienne ou Vaduz invoquèrent la « défense de l’unité monétaire » — formule hypocrite derrière laquelle se cachait l’unique volonté de protéger les rentiers, les spéculateurs et l’ordre stérile du capital dormant.
En France, frappée elle aussi par la crise, des poches de résistance surgirent dans les années 1930 et 1950. À Nice, le valor permit de soutenir les commerces de proximité ; dans le Cher, la « Commune libre » de Lignières-en-Berry relança le commerce local et freina l’exode rural grâce à ses bons d’achat fondants ; à Marans, en Charente-Maritime, des bons d’échange circulèrent pour arracher l’économie locale aux griffes des réseaux centralisés. Partout, la population accueillit ces monnaies nouvelles avec enthousiasme : elles donnaient aux paysans, aux artisans, aux familles une force de respiration face à l’étranglement financier. Mais là encore, le couperet tomba. En 1958, une ordonnance gouvernementale interdit toute monnaie parallèle sur le sol français, sacrifiant l’intérêt des villages à celui des créanciers et du capital oisif. Chaque fois que la France paysanne et laborieuse reprenait son souffle, Paris et la haute banque l’étouffaient.
Pourtant, certaines expériences ont traversé les décennies et continuent de défier l’ordre rentier. En Suisse, la Banque WIR, née en 1934, s’organisa en réseau coopératif interentreprises et survit encore aujourd’hui. Plus au nord, les caisses JAK suédoises et danoises, issues du même esprit, instaurèrent des prêts sans intérêt adossés à l’épargne mutuelle des membres, rappelant que le crédit doit être un service au travail, et non une rente prélevée par une caste de parasites. Enfin, en Bavière, le chiemgauer, lancé en 2003, démontre qu’une monnaie locale à perte programmée peut irriguer son territoire, financer associations et écoles, et replacer l’argent au service du peuple. Ces expériences, si différentes dans le temps et l’espace, disent toutes la même vérité : chaque fois que la monnaie retourne à la communauté, la vie reprend ; chaque fois qu’elle est reprise par l’État central et les banques, c’est l’immobilisme des rentiers qui triomphe.
Freiland
Dans un système franchiste, le terrain ne serait plus jamais vendu à titre privé. La collectivité en resterait propriétaire et l’affermerait par adjudication publique, selon un mécanisme clair : les baux (d’un an, cinq ans, dix ans ou à vie pour l’agriculture ; sans durée fixe mais révisables périodiquement pour l’habitat) seraient attribués au plus offrant, c’est-à-dire à celui qui s’engage à verser à la collectivité le montant le plus élevé de rente foncière. Cette rente, loin d’aller dans la poche d’un propriétaire absentéiste, reviendrait intégralement aux caisses locales pour financer voirie, écoles, entretien, services collectifs. Chaque renouvellement de bail permettrait d’ajuster le montant à la valeur réelle du sol, empêchant toute spéculation et assurant que la richesse du terrain profite toujours à la communauté qui l’entoure.
Des garanties protègent les familles : tant que les obligations du bail sont remplies, nul ne peut les expulser ; les héritiers disposent d’un droit de priorité sur le renouvellement (avec un rabais possible de 10 %), et l’appauvrissement volontaire du sol est interdit par contrat. Dans ce cadre, les ménages achèteraient uniquement le bâti (maison, annexes, ateliers), à son prix réel et non gonflé par la bulle foncière. Un crédit modeste de dix à quinze ans suffirait, avec des mensualités proportionnées aux salaires. La maison se transmettrait sans dette écrasante, tandis que le bail du terrain resterait attaché à la collectivité.
Henry George exprimait un objectif similaire. Cependant, là où George propose de taxer lourdement cette rente pour la redistribuer, Gesell veut aller plus loin : retirer purement et simplement le sol du marché spéculatif. L’un corrige, l’autre reconquiert. Dans un cadre nationaliste, cette mesure garantit à chaque famille de travailleurs un toit stable, rapidement payé et transmissible sans dette, tout en soustrayant les terres au capital transnational et en renforçant l’enracinement des foyers français sur leur sol.
Freihandel
Pour Gesell, le véritable libre-échange n’est pas le marché dérégulé vanté par les anarcho-capitalistes, mais un échange purifié de ses parasites : la rente, le monopole, la spéculation. Tant que la monnaie peut être thésaurisée et le sol accaparé, la “liberté” du commerce n’est qu’un masque pour l’oppression des puissants. Briser ces deux chaînes, c’est ouvrir la voie à un commerce réellement libre, où le petit producteur comme le grand peuvent vendre à égalité d’armes. Le freihandel gesellien n’abolit pas la propriété privée : il la libère de ses déformations. En supprimant la rente foncière et l’usure monétaire, la propriété productive cesse d’être un instrument de domination pour redevenir un outil de travail. Nul ne peut alors accumuler des terres ou du capital inactif simplement pour les retenir et en tirer un revenu : ils doivent circuler vers ceux qui les emploient réellement. Si la monnaie et la terre ne peuvent plus être retenues pour en tirer un revenu il ne restera au capital que la fonction productive. Ainsi se répartira naturellement la propriété sur un grand nombre, car rien ne pourra l’agréger artificiellement.
Ce mécanisme opère comme une redistribution organique, sans confiscation bureaucratique ni nivellement forcé. Les grandes concentrations de fortune se dissolvent d’elles-mêmes, et la propriété se répand comme une pluie fine sur le sol de la nation. L’ouvrier qualifié, l’artisan, le paysan peuvent alors, par leur travail et leur épargne, acquérir leurs outils et leur logement sans être captifs d’une dette éternelle. Le franchisme gesellien ne se contente pas de libérer les échanges : il assure que les instruments de production restent entre les mains de ceux qui les utilisent, et non de ceux qui les possèdent par héritage ou par spéculation. En ce sens, c’est un socialisme organique : il ne nie pas l’initiative individuelle, mais la protège contre les concentrations artificielles. Cette vision peut aussi rallier une forme de nationalisme économique, car un peuple dont la propriété productive est largement distribuée ne craint ni la mainmise du capital étranger, ni la guerre des monopoles transnationaux.
Silvio Gesell offre une boîte à outils intellectuelle et conceptuelle pour ceux qui veulent penser une économie nationale libérée de la mainmise financière. À une époque où les États reculent devant la toute-puissance des marchés et où la mondialisation uniformise nos modes de vie, ses idées méritent d’être redécouvertes comme piste de travail pour l’avenir. L’enjeu n’est pas d’ériger son système en dogme, mais de l’envisager comme un réservoir de concepts exploitables. Gesell rappelle que la monnaie et le foncier ne sont pas neutres et peuvent être armes d’asservissement ou instruments de libération.
En articulant ces trois piliers Gesell entend construire un système cohérent qui n’est ni le capitalisme libéral classique, ni le collectivisme marxiste. « L’économie monétaire libre » qu’il propose « n’est pas le laisser-faire, mais n’est pas non plus le communisme. Ce serait plutôt une économie de marché sans capitalisme, c’est-à-dire sans capitalisme financier », résume l’économiste Werner Onken. Gesell se situe ainsi dans une troisième voie originale : individualiste sur le plan entrepreneurial (il croit en l’initiative privée, la concurrence et l’esprit d’entreprise) mais anti-capitaliste sur le plan monétaire et foncier (il refuse que la possession de l’argent ou de la terre confère un pouvoir d’exploitation). Il s’inspire en cela autant du proudhonisme (l’anarchisme mutualiste opposé à la propriété lucrative) que des théories des physiocrates, tout en innovant sur le terrain monétaire. Cette synthèse inédite vise une société où la liberté d’entreprendre cohabite avec la justice sociale, grâce à des règles du jeu économiques empêchant l’accumulation indéfinie et l’asservissement des faibles par les puissants.
Appliquer ces idées, même partiellement, bouleverserait aussi la structure sociale. En supprimant l’usure et les rentes excessives, on réduirait les écarts artificiels de richesse ; la réussite découlerait du travail et du talent, et non de la spéculation ou de l’héritage foncier. Les ressources issues de la socialisation des rentes pourraient alors soutenir la famille, la santé, l’éducation – des piliers de la cohésion nationale. Finalement,
l’économie franche de Gesell ne se présente pas comme une panacée, mais comme un ensemble d’outils à explorer, à adapter, à discuter. Elle ouvre des perspectives : reprendre la main sur la monnaie, protéger le sol national, rééquilibrer les échanges et replacer l’économie sous l’autorité du politique. Pour les milieux attachés à la souveraineté et à l’identité, c’est un terrain fertile pour réfléchir, débattre et expérimenter. Comme le rappelle la maxime : l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître.
Clément Lemerle