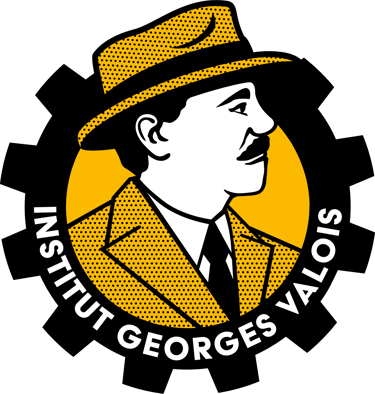Bullshit Job : la disparition du sens dans le travail
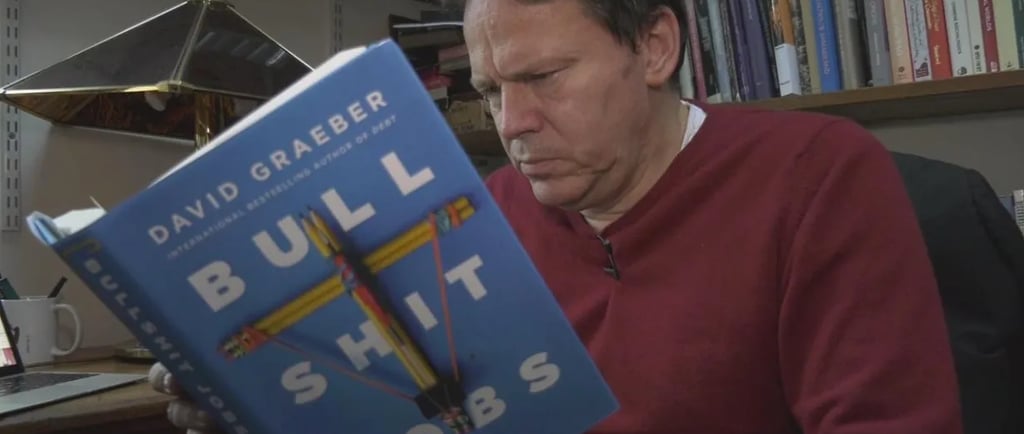

Et si votre travail était une perte de temps ?
Avez-vous déjà participé à une réunion dont il n’est ressorti ni information d’intérêt, ni décision ? Votre travail comporte t-il des règles dispensables qui alourdissent les procédures ? Avez-vous le temps de jouer à des jeux, de regarder des vidéos ou de faire des achats en ligne sur votre temps de travail ?
Si la réponse à l’une de ces questions est oui, il est possible que votre poste soit un bullshit job ; autrement dit, un symptôme de la perte de sens au sein de l’activité professionnelle à l’heure du capitalisme tardif.
1) La perte de sens au travail
L’idée de bullshit job est apparue pour la première fois en 2013 sur le site Strike ! sous la plume de l’anthropologue et militant anarchiste David Graeber, dans un article intitulé « On the Phenomenon of Bullshit Jobs : A Work Rant ». Cet article ayant eu un grand retentissement, l’universitaire a pensé utile de formaliser le concept dans un essai de 2018 « Bullshit Jobs : A Theory ». S’il est parfois traduit en « travail à la con », la polysémie laisse entendre qu’il est question de travail peu valorisés, ce que n’est pas le bullshit job.
Graeber le définit ainsi : « un emploi rémunéré si complètement inutile, superflu ou nuisible que même la personne qui l’occupe ne peut justifier son existence — bien qu’elle se sente obligée de prétendre que ce n’est pas le cas. » Le bullshit job est rémunéré, inutile ou dépourvu de sens social, reconnu comme tel par le travailleur lui-même et il nécessite une dissimulation (nous pourrions dire « la simulation d’un travail »).
Mon désaccord avec Graeber est qu’il confie au travailleur la tâche d’évaluer l’utilité de son emploi. Or, cela introduit un biais subjectif : l’utilité sociale devrait être définie par des critères objectifs, indépendants du ressenti individuel. Des critères concrets — absence de décisions, production de normes inutiles — pourraient mieux refléter la réalité. Indépendamment de son inutilité réelle, le travailleur bullshit peut se sentir utile, et c’est tout le sens de l’idéologie du travail. Il est donc hautement probable que le taux d’emplois inutiles soit sous-évalués par ceux-là même qui occupent ces postes.
Mais d’où vient cette prolifération d’emplois inutiles ? Si la perte de sens et l’inauthenticité sont des conséquences du bullshit job, certaines causes de son apparition peuvent être identifiées.
2) Les causes structurelles : capitalisme, bureaucratie, idéologie du travail
Ultime preuve de l’inexistence d’un homo œconomicus, le monde actuel du travail est profondément irrationnel. Il est possible de distinguer d’une part les mécaniques économiques qui expliquent la tertiarisation, de l’idéologie sans laquelle ce système s’effondrerait dans la minute.
Capitalisme et automatisation
Dès Lafargue et son « droit à la paresse », on a rendu crédible l’idée de réduction de temps de travail. Aujourd’hui et après une significative réduction, il apparaît que le salaire est de plus en plus décorrélé de notre rôle productif réel à mesure que le capitalisme se développe. Mais la situation contemporaine pousse cette logique à l’extrême : le salaire s’est peu à peu détaché de la contribution réelle.
Les travaux productifs se sont considérablement réduits en raison de l’automatisation, et s’en est suivie une augmentation des métiers de l’économie de service, dans lesquels il est significativement plus difficile d’augmenter la productivité. La seule manière de le faire est généralement en dégradant le service. Un médecin ne va pas faire plus de bénéfices en achetant un tensiomètre plus exact, mais en réduisant de 5 minutes chaque rendez-vous. La demande est moins extensible. Même en devenant riche, vous n’iriez pas deux fois plus souvent chez le coiffeur.
La généralisation de l’intelligence artificielle va être un raz de marée dans le travail tertiaire, mettant au chômage une population qualifiée, déclassant encore ceux qui luttaient pour maintenir péniblement leur niveau de vie. Pour autant, ce ne sont pas les bullshit jobs qui sont inquiétés. Ces boulots ne produisent déjà rien, ils ne sont qu’une justification pour les marchés financiers et un alibi pour les actionnaires.
Bureaucratie et illusion de l’efficacité
La crise du covid a montré qu’il existait des professions essentielles, et d’autres sans lesquelles la terre ne s’arrêtait pas de tourner. Graeber raconte d’ailleurs la délicieuse anecdote d’un employé de l’administration qui a tout bonnement arrêté de se présenter à son bureau. Ce n’est que six ans plus tard que l’employeur a remarqué son absence, alors que la structure allait lui remettre une médaille pour récompenser son ancienneté. Entre temps, l’employé était devenu un spécialiste de Spinoza.
Par ailleurs, dans ce nouveau monde du capitalisme bureaucratique, la valeur symbolique du travail supplante sa valeur réelle. Il serait possible de croire que seuls les métiers ayant une utilité survivraient au capitalisme. C’est pourtant tout l’inverse qui est en train de se passer. Alors que le temps de travail a, en Occident, connu une réduction historique, des hommes en col blanc passent des heures supp’ à … ne rien faire de très important. L’auteur note aussi que si les emplois inutiles nous font naturellement penser dans un premier temps à l’administration, c’est bien dans le secteur privé qu’il existe le plus de bullshit jobs, souvent en soutien des intérêts financiers. C’est le paradoxe : pourquoi le marché générerait-il des emplois qui ne produisent aucune richesse ? La réponse est simple. Parce que ça marche.
Le fait de participer à une activité pendant une longue durée, tant qu’elle est principalement payée, et pour le compte d’une entreprise ou de ses clients, suffit à devenir une vertu. Cette inversion paradoxale — où les métiers les moins utiles sont parfois les mieux rémunérés — souligne le caractère performatif du travail moderne : il ne s’agit plus de produire, mais de donner l’illusion de produire.
À l’université de Zurich, Simon Walo a mené une étude montrant que les catégories d’emplois de la finance, de la vente et du management ont une probabilité significativement plus élevée que d’autres de faire déclarer à ses travailleurs que leur travail est « socialement inutile » . Cela démontre assez bien que les mesures prises au nom de l’efficacité économique sont en réalité purement irrationnelles, par exemple le fait de surpayer dans les secteurs de la finance et de la banque des gens qui ne font rien. C’est la production de l’apparence d’efficacité qui est utilisée comme valeur marchande.
L’idéologie managériale moderne se tient des deux pieds sur l’idéologie bourgeoise du travail. Le petit patron est devenu un grand patron trop occupé par les investisseurs et les actionnaires pour surveiller ses employés. C’est donc au manager, le petit chef en chef, qu’il appartient de surveiller l’absence de travail de ses employés. C’est ce que Graeber désigne comme une « religion sécularisée du capitalisme ».
Graeber soulignait aussi qu’un peuple disposant de trop de temps libre était un danger mortel pour la classe dirigeante. Mais le temps passé à se rendre docile au système est du temps qui n’est pas utilisé pour préparer sa subversion. Face à ce constat, l’universitaire proposait une solution radicale : le revenu universel. Non pas comme simple mesure sociale, mais comme manière de dissocier la survie économique de la soumission à l’inutilité.
3) Les types de Bullshit jobs et leurs expressions contemporaines
The Office est une série humoristique diffusée à partir de 2005 sur la NBC qui suit une entreprise qui vend des ramettes de papier à l’heure de la dématérialisation. Il s’agit sans doute de l’une des meilleures satires populaires mettant en scène le bullshit job. Le sens du travail est perdu, les hiérarchies sont creuses, les procédures remplacent l’action, les apparences priment sur l’efficacité. Les 5 types de bullshit jobs identifiés et décrits par Graeber y sont tous présents.
Creed n’est au courant ni de la nature de son poste, ni de l’activité de l’entreprise, et n’a pas d’activité productive mais permet de combler les rangs pour faire exister la structure. Il est un faire-valoir, au même titre que l’esclave du pharaon dont le seul travail est de porter une palme pour le mettre en valeur.
Toby des ressources humaines s’occupe des relations sociales internes à l’entreprise. Sa seule utilité vient des dysfonctionnement internes. Il fait partie des rafistoleurs.
Angela de la conformité organise des fêtes d’entreprises thématiques aux règles absurdes pour la branche, participant d’une ritualisation bureaucratique de la vie sociale de l’entreprise. Elle est une cocheuse de cases.
Michael Scott est une caricature du manager qui pense “motiver” ses équipes avec des jeux et slogans, mais ne comprend pas les opérations de base. C’est l’archétype du manager inutile sans qui l’entreprise ne se porterait pas plus mal.
Dwight, l’assistant au manager régional, ne possède aucun pouvoir décisionnaire réel, et ne bénéficie que d’une autorité symbolique. Il fait semblant de commander quand son chef n’est pas là, mais personne n’y prête attention. Il est également un commercial agressif, il est donc un porte-flingue en plus d’être un manager inutile.
Au-delà de l’humour, la réalité du travail tertiaire apparaît clairement dans la série : ridicules guerres d’égo, compensation pour une vie personnelle vide, désintérêt franc et non dissimulé, aventure sociale dans laquelle le travail effectif passe au second plan. Chaque employé de bureau peut se reconnaître dans un ou plusieurs personnage de The Office, et dans un ou plusieurs archétypes de Graeber. Cette fiction illustre la tension centrale du capitalisme tertiaire : faire exister la structure plutôt que produire de la valeur réelle.
Le sentiment d’inutilité se distribue de manière inégale selon le genre, la classe et la génération. Commençons par la dimension genrée, sans doute l’une des plus révélatrices.
Une distinction genrée
Une étude menée au Royaume-Uni montrait que 42 % des hommes pensaient que leur travail est « sans signification », contre 32 % des femmes . Des chiffres analogues peuvent être observés dans d’autres pays occidentaux.
Comment l’expliquer ? Il est pertinent ici de pointer un rapport genré à la reconnaissance. Il y a un phénomène de déclassement masculin, en rapport avec le déclin de son rôle productif « classique », pour des emplois tertiaires aux fins abstraites. Cela conduit à l’affaiblissement de ce que Graeber appelle « le sentiment de contribution réelle ».
D’une part, les femmes travaillent davantage dans des secteurs considérés comme « utiles » (santé, petite enfance, social, administration publique), ce qui créé un effet de reconnaissance symbolique. Également, les femmes accordent plus d’importance aux dimensions relationnelles et symboliques du travail : sentiment d’appartenance, contribution sociale indirecte, stabilité. Leur socialisation les font valoriser le rôle social et la reconnaissance collective, même si le travail en lui-même est peu utile ou bien répétitif . Barbara Czarniawska, spécialiste en sociologie des organisations, montre par exemple que les femmes dans les administrations publiques développent souvent un attachement à leur rôle social, indépendamment de la “valeur productive” de leurs tâches. Enfin, il est probable que faisant de plus en plus d’études longues et faisant moins d’enfants, elles y trouvent une compensation sociale.
Secrétariat, RH, fonctions de support et back-office sont des métiers très féminisés dans lesquels elles peuvent s’épanouir. Cette crise semble donc moins impacter les femmes, qui sont moins affectées subjectivement par la perte de sens, en raison d’un biais valorisant davantage la socialisation et de perception du travail.
La bureaucratie inversée
Le monde du travail contemporain est traversé par une autre mutation : la mise en scène du travail. L’apparence d’activité devient une fin en soi : réunions sans enjeu, reporting, PowerPoint. C’est ce que Graeber appelait une “bureaucratie inversée” : la forme prime sur le fond. Le management se fait paternalisme, et l’entreprise, église. L’objectif n’est plus de travailler, mais de croire au travail et à ses valeurs. La boîte doit créer artificiellement du sens (« meaning gap ») à coup de séminaires, de coaching, de storytelling.
Il y a un phénomène d’infantilisation : le manager et l’entreprise qui se prennent pour les parents des employés. Le manager doit occuper ses salariés-enfants, comme une nounou dans la garderie capitaliste. Le vice va parfois jusqu’à expliquer aux employés que lorsqu’on leur refuse une augmentation ou une prime, c’est pour leur bien.
Enfin, le bullshit job est une économie de l’attention, un monstre vorace dont le but premier est de dévorer tout le temps qu’il peut vous prendre. Moins vous avez de temps disponible, moins vous avez le temps d’y penser, de remettre en cause ses effets pervers, de critiquer voire de dénoncer ce système.
La vie de consommateur du travailleur bullshit
Le bullshiteur a un bon pouvoir d’achat, mais son capital symbolique est frustré de ne rien produire. Au sein de cette classe, certains dépensent volontiers leur pécule en consommation ostentatoire « nouveau riche », espérant transformer le bullshit en ascension sociale par le port de marques tendances. Pour les autres, à qui les premiers semblent vulgaires, ce sera au contraire une consommation éthiquement responsable, pour chercher à équilibrer avec un travail qui ne l’est pas.
Dans une étude du CREDOC de 2022, on apprend que les cadres supérieurs sont les plus nombreux à déclarer “vouloir consommer de manière éthique”, même si leur empreinte carbone réelle reste élevée. De toute évidence, il subsiste une dissonance entre leurs valeurs et leur mode de vie. Pourtant les employés en bullshit ne lésinent pas sur les investissements dans la conso bien-être : tapis de yoga, diffuseur d’huiles essentielles, fauteuil de bureau assis-debout, plante grasse dont on a oublié le nom, le livre de développement personnel en tête de gondole de la FNAC.
Il est aussi possible de remarquer une forte dépendance aux services numériques : (Uber, Amazon Prime, …) utilisés peut-être comme une manière de racheter du temps libre. Le repas livré chaque midi semble justifier un salaire injustifié par le travail fourni. Il y a évidemment la fuite symbolique : concerts, soirées, festival, ou bien à l’inverse la recherche de l’authenticité, entre randonnées et gastronomie.
Ainsi se dessine une économie du simulacre, où l’achat, la détente et la quête d’authenticité sont absorbés par la même logique : celle de l’entretien du vide. Le consommateur bullshit ne cherche plus à combler un manque, mais à se persuader qu’il existe encore. Il ne croit plus au sens de son travail, mais il croit encore aux objets qui prétendent lui en redonner un.
Pourtant, cette fuite dans la consommation ne satisfait pas tout le monde. La génération Zoomer exprime son désenchantement par le refus pur et simple du jeu social du travail.
4) Du désenchantement à la quête de sens
Les jeunes diplômés arrivent dans des emplois où la dimension rituelle et le décorum comptent plus que le travail pour lequel ils ont passé des années à étudier. Ils ne veulent pas participer à ce jeu de dupes. Ils n’ont pas le besoin criant de reconnaissance sociale des milleniaux. Ils n’ont plus le besoin de la stabilité des générations précédentes, car ils savent très bien que cette stabilité n’existe plus. Ils veulent avoir de l’argent comptant car ils n’auront pas de retraite, et sont prêts à ne rien laisser passer dans le comportement ou dans leur traitement.
Le zoomer stare : une réponse générationnelle
Le zoomer est, plus encore que ses prédécesseurs, en quête d’authenticité. Il ne veut pas participer à la cagnotte pour le départ d’un salarié à qui il n’a jamais parlé, ne veut pas déjeuner avec ses collègues, et ne veut surtout pas que sa vie sociale se résume à son environnement de travail.
Un nom, le zoomer stare (le regard zoomer), a été donné pour désigner ce regard vide de toute expression, comme une fatigue émotionnelle. Cela a créé un réel fossé dans la vie sociale avec les autres générations mises mal à l’aise. La génération est déjà connue pour claquer la porte à la moindre contrariété, ne laissant pas passer le moindre manque de respect.
Il y a plusieurs raisons à cela : les carrières sont beaucoup plus dissoutes aujourd’hui. Le zoomer sait mieux que quiconque qu’il y a peu de chances qu’il soit encore dans cette boite dans 3 ans, et il n’en a même pas envie. Il recherche une sociabilité basée sur des centres d’intérêts.
Ils sont prêts à passer s’il le faut dans la « gig economy », celle de l’entreprenariat libéral, des petites missions payées à la tâche. Mais dans la plupart des cas, il s’agit d’un déplacement du vide, et non pas une réelle échappatoire. L’employé déçu de son bullshit job démissionne pour se lancer dans le marketing digital et passe bientôt ses journées à postuler à des missions sous-payées, à faire des devis, relancer ses clients, gérer sa communication et sa micro-comptabilité. Le rêve entrepreneurial est lui aussi mort, avec perte et fracas.
Une réalisation progressive : la stratégie d’évitement des bullshit jobs
Le travail est devenu la punition d’un Sisyphe malheureux, incapable de donner un sens à son activité professionnelle, chose totalement originale dans l’histoire humaine. Jamais le travailleur n’a été comme aujourd’hui l’objet d’une mise au banc de son rôle productif.
Le covid et la démocratisation du mot valise « Bullshit job » ont fait prendre conscience à beaucoup de l’inutilité de leur travail. Certains ont changé de voie, recherchant un travail plus manuel, d’artisanat. Pourtant, la moitié de ceux qui se disent insatisfait indiquaient qu’ils ne quitteraient pas leur travail dans les 12 prochains mois, comme s’il n’existait pas d’alternative crédible dans leur situation. En revanche, ils peuvent revoir leur engagement envers la boîte, en ne fournissant pas tous les efforts attendus, ce que les anglo-saxons appellent le « quiet quitting ». Une démission silencieuse, à l’image de celle du fanatique de Spinoza.
Une étude de l’association Projet Sens (juin 2023) indique que 43 % des salariés français envisagent de « quitter leur emploi pour un autre ayant plus de sens » dans les deux ans à venir. Plus encore, 90 % des salariés souhaiteraient se reconvertir ! Enfin, une enquête de 2020 indique que 63 % des Français estiment que leur travail « manque de sens ».
S’il y a effectivement une flexibilité nouvelle dans le travail, (non souhaitée : temps de trajet, horaires changeants, etc) le capitalisme a tout intérêt à faire croire à une volatilité de la réalité du travail pour susciter de nouveaux marchés et de nouvelles pratiques dont il sera bénéficiaire.
Baptiste Rappin indiquait qu’il y avait une surestimation du phénomène de « Big quit », qui consisterait à la réorientation, supposée massive, des employés du bullshit vers un travail comportant plus de sens. En réalité le chiffre oscille généralement entre 2 % et 8 % au pic de la séquence, avant de redescendre et de se restabiliser.
5) Quelle refondation du travail ?
« Le dommage moral et spirituel qui découle de cette situation est profond. C’est une plaie au travers de notre âme collective . » nous dit Graeber. Ce sentiment d’inauthenticité ressenti par des millions de personnes en France et à travers le monde pose les questions du bien-être et de la souffrance au travail avec une urgence nouvelle.
Le bullshit job n’est pas une anomalie du capitalisme moderne, mais peut-être son expression la plus cohérente : une activité sans finalité, soutenue par l’idéologie de la performance et la peur du vide. Pourtant, la crise du sens qu’il révèle pourrait ouvrir la voie à un renouveau : revalorisation du travail concret, réduction du temps de travail, ou encore déconnexion symbolique entre emploi et valeur personnelle. La question n’est plus : avons-nous un bullshit job ? Mais plutôt : comment lui redonner du sens ?
La forme du travail est un révélateur moral, qui distingue ceux qui se vendent corps et âmes au capitalisme avec l’ambition d’une feuille morte, et ceux qui le subissent, désenchantés, en quête d’une porte de sortie qu’ils n’en peuvent plus d’attendre.