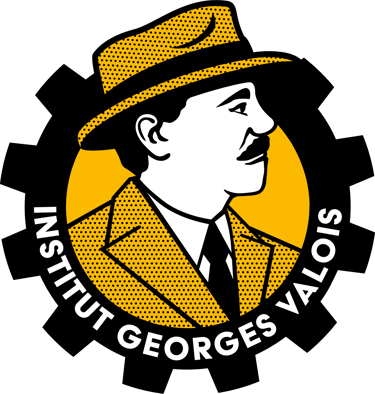Le défi agricole français face à l’UE


L’enjeu agricole auquel la France est sujette, est complexe et multidimensionnel : il touche non seulement les agriculteurs, mais aussi l'ensemble de la société française. La France, premier producteur agricole de l'UE, se trouve à la croisée des chemins entre la nécessité de préserver son modèle agricole traditionnel et l'impératif d'adaptation aux nouvelles régulations européennes, aux défis environnementaux et aux évolutions du marché mondial. Ce défi est accentué par les particularités de la Politique Agricole Commune (PAC), les évolutions économiques et technologiques, ainsi que par les attentes sociétales croissantes en matière de durabilité, de sécurité alimentaire et de respect de l'environnement.
La Politique Agricole Commune (PAC) de plus en plus controversée
La PAC, instaurée en 1962, a longtemps constitué le pilier central du soutien aux agriculteurs français. Elle a favorisé la stabilité des recettes agricoles, l'accroissement de la production et la garantie de l'approvisionnement en nourriture pour l'Europe. Néanmoins, la PAC est également réputée pour ses conséquences néfastes comme une production excessive, une uniformisation des paysages agricoles et une détérioration de l'environnement. Au fil des réformes, la PAC s'est progressivement dirigée vers une agriculture plus écologique, en particulier grâce aux paiements directs conditionnés par le respect de normes environnementales et l'élaboration de dispositifs agro-environnementaux.
Cependant, ces évolutions ne se font pas sans heurts pour les agriculteurs français. La complexité administrative, les exigences environnementales croissantes, et la réduction des aides directes pour certains secteurs mettent sous pression de nombreux exploitants. Par ailleurs, l'ouverture des marchés et la diminution des protections douanières inscrites dans les réformes de la PAC exposent les agriculteurs français à une concurrence internationale accumulée et souvent déloyale en raison des différences de normes de production dans les autres pays.
Effectivement, la mondialisation, accentuée par les accords commerciaux internationaux signés sous l’égide de l’Union européenne, constitue une autre menace majeure pour l’agriculture française. Les accords comme le CETA, le dernier avec la Nouvelle-Zélande et le Mercosur qui est en négociation (au moment où je rédige cet article) sont perçus comme une trahison des intérêts français, car ils permettent l’entrée massive de produits agricoles provenant de pays où les standards de qualité et de production sont largement inférieurs. Ces accords créent une concurrence déloyale qui affaiblit les producteurs français, forcés de se plier à des normes strictes tout en étant écrasés par des prix importés qui ne couvrent même pas leurs coûts de production.
On a pu voir des séquences médiatiques durant le dernier mouvement social agricole où des agriculteurs Français s’en prenaient directement à des camions transportant du vin espagnol, ce qui symbolise bien le ras le bol du libre-échangisme dans le secteur viticole.
Les produits agricoles français se voient relégués au second plan au profit d’une logique de marché qui privilégie le volume et le profit immédiat. Cela conduit à une dévalorisation des labels de qualité qui font la fierté de notre pays et qui sont prisés par les consommateurs. Il est donc logique que la France réaffirme sa préférence nationale en matière agricole en limitant drastiquement les importations de produits étrangers et en rétablissant des barrières douanières protectrices.
La transition écologique : une opportunité pour renforcer l’indépendance
Si la transition écologique est un impératif, elle ne doit pas être imposée par des technocrates européens déconnectés des réalités locales et qui n’ont aucune légitimité. La France a en effet les ressources et les compétences pour mener sa propre transition agricole de manière souveraine sans avoir à suivre les directives imposées par Bruxelles. Plutôt que de se soumettre à des quotas de plus en plus absurdes ou à des objectifs irréalistes comme ceux fixés par le « Green Deal » européen, la France doit s’investir dans un modèle agricole durable fondé sur ses propres besoins et ses priorités.
L’agriculture biologique, qui est en plein essor, pourrait être une opportunité pour la France de retrouver une forme d’autonomie alimentaire tout en répondant aux attentes des consommateurs français, de plus en plus soucieux de la qualité et de l’origine de leurs aliments. Le modèle de petites exploitations locales qui favorisent les circuits courts, est à privilégier puisqu’il réduit la dépendance aux marchés internationaux et renforce la souveraineté alimentaire du pays. Cela implique de promouvoir une agriculture de qualité, ancrée dans le terroir français, et de refuser les compromis imposés par l’UE pour faciliter les échanges commerciaux mondiaux.
Les nouvelles technologies et la défense des intérêts nationaux
L’agriculture française, pour rester compétitive tout en restant fidèle à ses traditions, doit s’appuyer sur les nouvelles technologies, mais avec discernement. L’innovation technologique peut évidemment permettre d’améliorer les rendements et de réduire l’impact environnemental, mais il est nécessaire que ces technologies soient développées et maîtrisées par la France elle-même. Dépendre de géants internationaux ou de multinationales pour l’agriculture de précision ou la biotechnologie serait une nouvelle forme de subordination.
Une politique volontariste où l’État joue un rôle central dans le développement des nouvelles technologies agricoles en favorisant les entreprises nationales et en soutenant la recherche publique permettrait à la France de ne pas être à la merci de multinationales étrangères, qui dominent le secteur agroalimentaire mondial. De plus, il est impératif de protéger les agriculteurs contre les pressions exercées pour adopter des pratiques controversées comme les OGM, qui menacent la biodiversité et l’indépendance alimentaire.
L'avenir de l'agriculture française dans l'UE
L'agriculture dépasse largement le cadre d'une simple activité économique : elle assure la sécurité des aliments et l'autonomie du pays. Dans un monde globalisé où les chaînes d'approvisionnement deviennent de plus en plus vulnérables, il est plus que nécessaire que la France retrouve sa souveraineté dans le domaine alimentaire.
Un retour à une production agricole nationale, soutenue par des limites tarifaires, donnerait la possibilité à la France de maintenir son autonomie alimentaire tout en préservant la qualité et la singularité de ses récoltes. L'objectif est de valoriser les professions agricoles, de sauvegarder le patrimoine rural et d'éradiquer un modèle de marché qui considère les agriculteurs comme des piliers d'un système mondialisé.
Pour conclure, face aux enjeux de l'Union européenne et de la mondialisation, il est nécessaire que l'agriculture française se redéfinisse en réaffirmant sa souveraineté. Pour assurer la sécurité de l'alimentation des Français, il est primordial de défendre les agriculteurs, les terres et notre savoir-faire. Il est impératif que la France reprenne le contrôle de sa politique agricole et ne se laisse pas submerger par des institutions européennes qui agissent uniquement au nom d’un marché unique inégal. Seule une agriculture nationale, forte et autonome, sera capable de relever les défis du XXIe siècle.