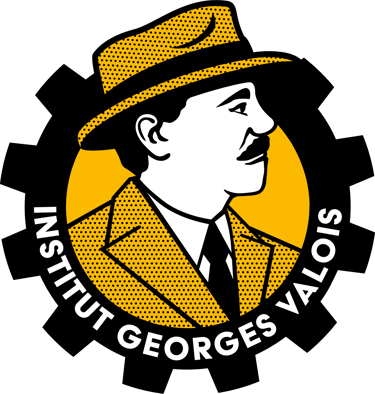Révolution, réaction et fascisme


« Tout commence en mystique et finit en politique. » Cette célèbre phrase de Péguy, tirée de Notre Jeunesse, illustre à merveille l’écueil sur lequel se heurtent toujours les mouvements politiques radicaux. Leur naissance est un jaillissement, une rivière souterraine qui sourd et devient un torrent furieux. Combien de temps avant qu’il devienne un fleuve tranquille ? Le fascisme italien exerce chez les nationalistes révolutionnaires une influence considérable. Il est pour beaucoup un modèle, un guide, tant en matière de politique que de mystique. Mais nous est-il encore permis de refuser de réfléchir sur la réalité de ce que fut ce fascisme et l’orientation que lui fit prendre le Duce ?
L’on a pris la mauvaise habitude – la faute à une grande partie de l’historiographie actuelle doublée d’une certaine paresse intellectuelle – de considérer le fascisme comme un bloc monolithique, uni derrière Mussolini, balayant ainsi d’un revers de main les fortes oppositions intérieures. Quelles sont-elles ? Monarchistes contre républicains, centralisateurs et décentralisateurs, catholiques et athées. En clair : réactionnaires contre-révolutionnaires. Refuser de voir les oppositions internes au fascisme revient à sombrer avec lui sans espoir de tirer les leçons qu’il a à nous enseigner.
Si le signor Mussolini a créé le fascisme, il est également responsable de sa faillite intellectuelle et du travestissement de son but originel. Le fascisme est né du profond besoin de révolution en Italie après la Grande Guerre. Entre misère et espoirs déçus par la vittoria mutilata, après un conflit meurtrier ayant mis à genoux l’économie italienne, une rage sourde couve dans le cœur des Italiens. Lorsqu’il crée les Fasci italiani di combattimento à Milan, Mussolini répond à cet élan révolutionnaire. Il en fait partie. Il est de ces socialistes révolutionnaires excommuniés par le PSI, qui proclame avec des anarchistes, des futuristes, des arditi, des anciens combattants que l’Italie doit briser les chaînes du conservatisme : détruire la monarchie en faveur d’une république décentralisée, abolir la noblesse, se soustraire au cléricalisme étouffant.
Pourtant, la déviation fut rapide. La faute, sans doute, à l’enjeu politique : freiner la percée communiste du biennio rosso. La bourgeoisie italienne, terrifiée à l’idée d’une révolution communiste et frappée par l’impuissance du régime en place, plaça ses espoirs dans les fasci qui fleurissaient partout en Italie. Et Mussolini de bluffer, lançant la marche sur Rome. Le gouvernement panique. Seul le roi peut encore briser la vague, déclarer l’État d’urgence et écraser l’insurrection. Il ne le fait pas. La démocratie parlementaire italienne tombe comme un fruit mûr dans la main du Duce. Mussolini a réussi son audacieux coup de main. Le fascisme, lui, vit ses dernières heures.
Comme un raz-de-marée, le fascisme emporte tout, ou presque en Italie. En quelques années, le fascisme triomphe partout, s’impose partout. On est séduit par lui jusque dans le clergé – voyez l’exploit ! Il n’y a guère que dans l’armée que prime encore la fidélité au roi. Mais plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Dès l’accession au pouvoir, Mussolini dégaine un tournant libéral, un an seulement après la nouvelle politique économique de Lénine. Le Duce clame vouloir désengager l’État de l’économie. Mais en dépit de ses influences soréliennes, ce n’est pas aux travailleurs qu’échut la direction de l’économie.
Le véritable tournant est la Charte du travail de 1927. L’État total était de retour et il avait de grandes ambitions. Mussolini, renouant quelque peu avec le fascisme originel, charge Giuseppe Bottai de fonder une nouvelle organisation du travail, une organisation corporatiste s’inspirant de la Charte du Carnaro d’Alceste de Ambris. La nation italienne y est définie comme un organisme moral, politique et économique vivant, que l’État fasciste réalise pleinement. L’État italien annexe l’économie comme il a annexé l’individu et les communautés. Les vrais vainqueurs, cependant, se trouvent chez les grands industriels et chez les grands propriétaires terriens.
Il est dans la nature de l’État d’avoir de l’ambition. Si l’on couple à cela la propension des nationalistes à s’attacher à la gloriole de la conquête, l’ambition devient alors dévorante, gare à l’imprudent qui s’y opposerait. On a beau eu parler de « quatrième Italie », en vérité, l’Italie fasciste, qui se disait révolutionnaire, n’a pas réussi à s’émanciper du rêve impérial romain et de la mare nostrum. Une illusion dangereuse, qui nourrit l’impérialisme d’une nation bien jeune dans l’Europe de la première moitié du XXe siècle. Mussolini avait-il d’autres choix que de pactiser avec les grands industriels, avec les grands trusts de l’acier, de l’automobile, etc. ? N’avait-on fait tout cela que pour revenir au point de départ ? Non pas se débarrasser de la ploutocratie mais changer la bureaucratie qui l’encadre ?
L’on croit, à tort, que Mussolini c’est le fascisme et que le fascisme c’est Mussolini. Qu’il était la seule voie italienne vers le fascisme. Aurions-nous si peu d’imagination que nous ne pourrions imaginer un autre fascisme qu’une bureaucratie sans âme au service d’un État obèse et d’une ploutocratie va-t’en-guerre ? L’Italie fasciste a connu maintes oppositions en son sein. Le Duce a pu créer autour de sa personne un culte mystique quasi-religieux, et faire graviter autour de lui ses adorateurs. Sa mort garantissait presque certainement la fin du régime. Contre lui s’élevèrent les voix dissidentes des chefs squadristes provinciaux, porteurs d’un autre fascisme, plus décentralisateur et moins dirigiste. En s’instituant et en s’étatisant, le fascisme s’est avachi sur lui-même. Toute impulsion est vouée à mourir de sa propre inertie, c’est pourquoi toute révolution doit être constructrice.
Le fascisme est encore aujourd’hui une source d’inspiration majeure chez tous les penseurs qui s’attachent à rechercher une troisième voie, la pierre philosophale du nationalisme. Se référer à une idéologie ou un régime passé oblige à une réflexion profonde et mesurée, à une analyse critique de la chose en question, à la fois en son temps et par rapport au nôtre. Il n’est pas acceptable de se complaire dans une médiocrité intellectuelle où telle ou telle idéologie passée sert de béquille et justifie de ne pas chercher de solution présentes aux problèmes actuels. Le romantisme fasciste masque les impérities d’un régime bureaucratique et monopolisé par le pouvoir personnel d’un homme loin d’être infaillible. Quiconque se réclamant du fascisme ou s’en inspirant ferait bien de l’étudier sérieusement et d’en chercher les causes de décès.
Le « mussolinisme » est une révolution ratée. Il ne tient qu’aux gens qui ont un peu d’esprit d’en tirer les leçons qu’il faut. De la question du césarisme à celle du fédéralisme en passant par la nature du pouvoir économique de l’État ou le rôle des masses en politique, le fascisme interroge encore le contemporain, a fortiori le nationaliste révolutionnaire. À nous de rejeter le confort intellectuel. À nous de ne pas nous contenter de nous reposer sur de vieilles pierres. À nous d’édifier et de stupéfier.